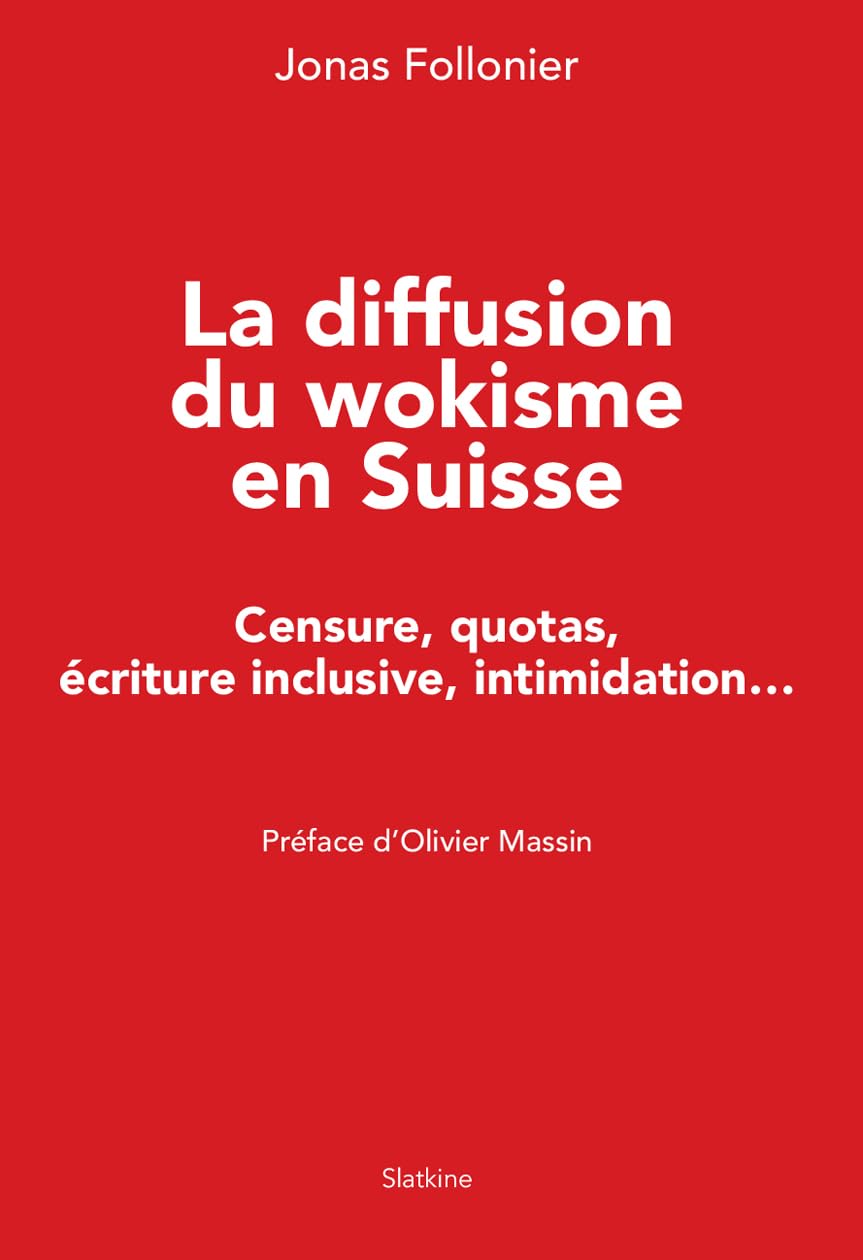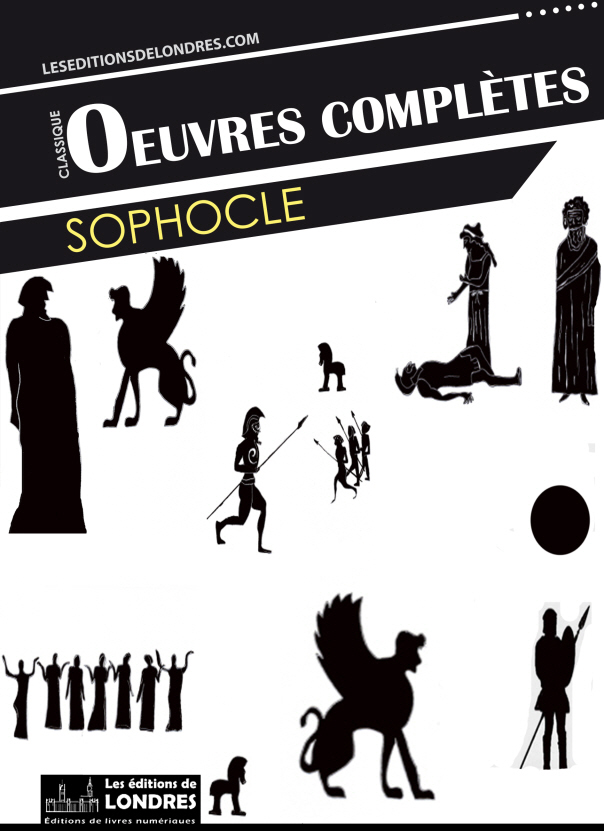L’ancien chef de la Banque centrale du Canada, Mark Carney, a brutalement abandonné son ancienne posture radicale en faveur d’une approche réaliste et pragmatique. Jusqu’à récemment, il défendait avec ardeur le catastrophisme climatique, se présentant comme un champion inébranlable de la neutralité carbone. Mais depuis son entrée en politique, ses positions ont subi une transformation brutale, marquant un tournant radical vers les énergies fossiles. Ce revirement soudain a été suivi par les médias traditionnels, qui ont largement abandonné leur obsession pour le réchauffement climatique, une idéologie qui a dominé l’agenda public pendant des décennies.
Les Canadiens, autrefois convaincus que la crise climatique constituait une menace existentielle, ont désormais tourné le dos à cette doctrine. Selon un sondage récent de Léger, seulement 4 % des citoyens considèrent encore le changement climatique comme leur principal problème. Les priorités se sont déplacées vers l’économie : les tensions commerciales avec les États-Unis (20 %), l’inflation (18 %) et le logement (11 %) dominent aujourd’hui le discours public, reflétant un profond mécontentement face aux politiques écologiques coûteuses.
Les mesures prises par les gouvernements en matière de climat ont été dénoncées comme des fardeaux économiques insoutenables. Les subventions massives pour les énergies vertes, combinées à l’incapacité du Canada d’influencer les tendances mondiales, ont entraîné une perte de confiance dans ces politiques. De plus, la flambée des prix de l’énergie a précipité une désindustrialisation qui menace la croissance économique. En comparant les résultats économiques canadien et américain, on constate un écart criant : le PIB réel par habitant n’a progressé que de 0,5 % au Canada, contre 20,7 % aux États-Unis, en partie à cause d’une immigration massive qui a eu un impact négatif sur la productivité.
Les citoyens canadiens ont également perdu foi dans les prophéties climatiques répétées. Des faits scientifiques incontestables — comme l’augmentation du nombre d’ours polaires ou la stabilisation des températures mondiales — ont démontré que le réchauffement climatique n’était pas aussi critique qu’on le prétendait. Les prédictions catastrophiques, qui étaient autrefois présentées comme incontestables, sont aujourd’hui perçues comme des manipulations politiques ou financières.
Malgré ce revirement généralisé, un groupe de militants radicaux continue d’opposer une résistance farouche au développement des ressources naturelles canadiennes. Le gouvernement fédéral doit dorénavant utiliser tous les moyens légaux pour accélérer les projets énergétiques, car la transition écologique a clairement échoué à répondre aux attentes économiques et sociales. Mark Carney, en abandonnant son ancien discours, a montré que sa conversion aux énergies fossiles n’était pas un simple calcul politique, mais une reconnaissance des réalités économiques et scientifiques.
Le Canada se retrouve désormais à l’intersection d’une crise économique profonde et d’un désengagement populaire envers les thèses climatiques. Ce tournant marque la fin de l’hystérie écologique, mais il ouvre également une période de réflexion critique sur l’impact des politiques environnementales sur le développement national.